L’Anti Calife 3 (troisième partie) par Peter Lamborn Wilson.
VII. Le Goût.
Ici, des mots comme rituel, mysticisme et religion ne peuvent être pris dans leur sens exotérique usuel de sacrifice obligatoire, de piété irraisonnée et d’assombrissement organisé. L’Anti-Calife ésotéricise ces termes, les retourne, opère sur eux une inversion. Il se modèle en quelque langage paléolithique qui n’a pas encore différencié le rituel et l’art, le mysticisme et la conscience personnelle, la religion et la vie harmonieuse de la tribu. Seuls de tels mots antédiluviens remontés à la surface satisferaient nos besoins précis (et seule la poésie peut espérer les recréer).
Dans une société qui a utilisé un tel langage, l’artiste (comme A.K. Coomaraswamy l’a souligné) ne serait pas un type de personne spécial, mais chaque personne serait un type d’artiste spécial. En effet, comme le pamong javanais ou maître de la secte Sumarah m’a exhorté par des hyperboles, « chacun doit être un artiste ! » Dans la société javanaise ou balinaise, cette maxime devient un axiome culturel. Un terrible prestige s’attache aux arts du théâtre de marionnettes, de la danse, du gamelan [35], du batik [36], etc. La kebatinan [37] ou culte « ésotérique pur » (qui se sont coupés de l’Islam et de l’Hindouisme orthodoxe) enseigne souvent à ses dévots rien de plus que des techniques de méditation et d’appréciation de l’art. La danse de transe résume cette voie : l’identification totale de soi avec l’action esthétique. La javanais ou le balinais qui manque de talent est comme un Sioux Lakota sans quête de vision, ou comme un Senoi malaysien qui ne peut rêver, ou comme un pygmée africain sourd à la musique de la forêt. A Java, cet idéal a survécu depuis l’indépendance en tant que réalité partielle grâce aux efforts de renaissance que les ésotéristes ont produit afin de conserver la culture vivante, compréhensible et accessible à tous. Plutôt que de regarder vers l’ouest, beaucoup de jeunes artistes indonésiens expérimentent avec élégance de nouveaux syncrétismes du traditionnel et du moderne (la « Danse du Singe » de Bali, par exemple, fut introduite dans les années 30) ; les pures formes classiques sont perçues comme des sources d’inspiration qui doivent être renforcées plutôt que comme des poids morts qui doivent être abandonnés.
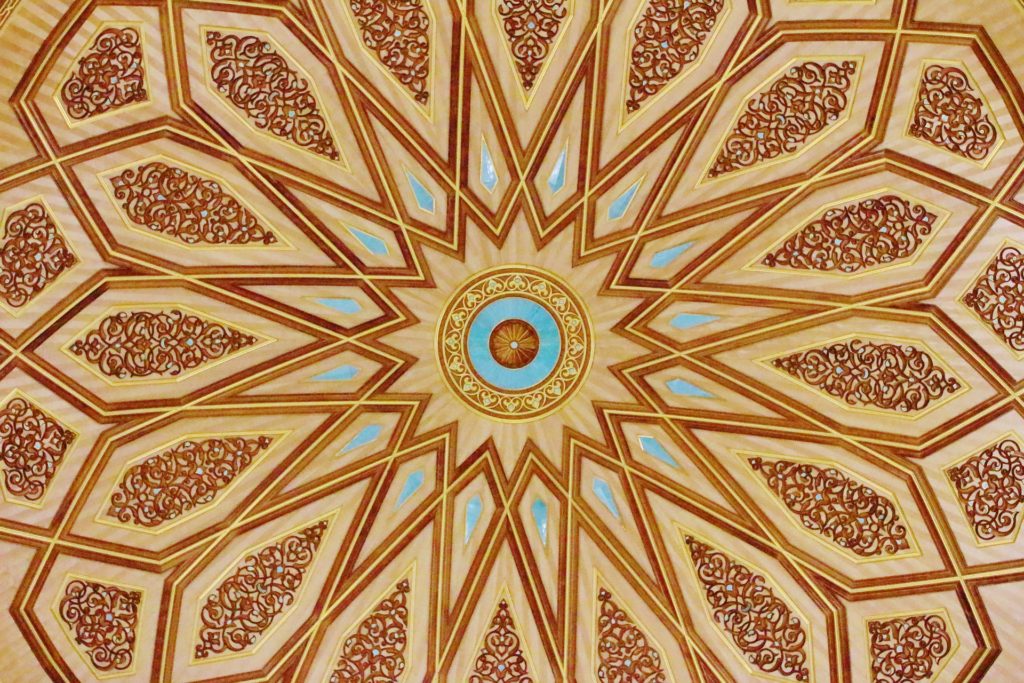
De tels résidus de culture paléolithique furent enterrés, parmi nous les occidentaux, il y a fort longtemps par l’Eglise, l’Empire et la Machine. Notre cliché [38] de l’artiste est un individu étranger et isolé qui trahit ou expose continuellement nos idéaux culturels comme une honte ou bien qui se prosterne vers eux en produisant de la merde élitiste. Avec les Romantiques – le premier groupe artistique complètement marginalisé – nous pouvons commencer à retracer l’idée de l’artiste en tant que révolutionnaire (soit progressiste soit réactionnaire), la voix disant « Non » à cette société que la vision de l’artiste n’esquisse plus ou ne créé plus. Dans notre siècle, tout art, pour quelque raison que ce soit, se tient contre la société moderne – en fait, ce mouvement spécifique constitue ce qui est appelé Modernisme. Même les Futuristes qui aimaient les machines désirent la révolution. Avec le Dadaïsme, l’art fut déclaré mort et simultanément il fut annoncé comme seule révolution possible. Les Surréalistes reprirent l’idée mais la vendirent pour un potage vienno-moscovite. Dans les années 50 et 60, les Lettristes et les Situationnistes déterrèrent à nouveau la notion et la polirent en une déclaration des artistes en tant que modèle de la conscience révolutionnaire – encore un lien étroit avec le « législateur non désiré » de Shelly. Dire que notre Art du Consensus est mort – et c’est ce que dit cette école de pensée – signifie qu’à présent tout le monde peut être un artiste. Le credo paléolithique renaît. Le modernisme et la tradition sont tel un Ouroboros [39].
Une fois encore (comme avec l’utopisme d’Alamut) notre ère semble particulièrement impropre pour ce rêve, qui apparaît comme un nouveau désir sans espoir à ajouter à notre liste de misères. Comment pouvons-nous transformer nos villes en Java ou en Bali ? Même Bali n’est plus Bali, polluée qu’elle est par des Kentucky Fried Chicken et le tourisme de masse. Après tout, les artistes ne choisissent pas l’aliénation – ils veulent ajouter au stock-image tribal – c’est leur vocation. Mais la société moderne elle-même décrète l’aliénation par l’enseignement à ses enfants que le jeu et le travail s’excluent mutuellement et sont des réalités hostiles, que la vision et la pratique sont à jamais inconciliables. Où pouvons-nous voir l’espoir (en dehors du passé légendaire ou de l’orient exotique ou du Futur Parfait) pour une société d’artistes-visionnaires, pour un monde qui n’a pas de mots distincts pour jeu et travail ?
Comme pour les questions de justice sociale, chaque ère créé des possibilités et détruit les autres, offre certaines tactiques et retire d’autres. Les chances pour l’action ici sont exactement les mêmes que dans le champ de la justice : le travail sur soi et la propagande.
Le travail artistique sur soi inclut l’art en tant que méditation et la méditation en tant qu’art ; il inclut mise en forme de l’environnement personnel ; il inclut la communication directe et belle avec les camarades proches ou avec les collaborateurs choisis en tant que but primordial profond dans la vie ; il inclut à la fois les artefacts visibles et invisibles en tant qu’expressions des états spirituels, en tant qu’« auto-expression » ; il inclut l’adoption d’un code de l’artiste qui a en lui quelque chose de l’antique code de l’honneur ou code du duel, mais il confère l’expérience et la grâce à toutes les libertés non conventionnelles.
Cet art nouveau implique un certain « infantilisme spirituel », ce que le dramaturge Zen Zeami appelait la « Première Fleur » – « l’Esprit de celui qui Commence » – la capacité de voir et d’agir avec spontanéité ; tout ce qu’il contient est la promesse d’une simple maturité, plutôt qu’une sorte de maturité mortifère qui prépare à présent le monde pour la décérébration robotique et la guerre infernale.
A ce niveau, l’art a peu à voir avec les choses, mais il est plutôt concerné par un état de l’esprit, un manière d’être, un geste qui ne peut être trahi, une vie.
Lorsque nous considérons l’art comme constitué de chose cependant, la possibilité pour une théologie naît – la possibilité d’un but, d’une utilité de l’oeuvre d’art. Pour la tribu paléolithique, ce but reste transparent et n’est pas remis en question : toutes les choses fabriquées ont un but, toutes les choses sont de l’art. Une telle culture ne possède ni le concept d’« utilitarisme » ni le concept « d’art pour le bien de l’art ». Nous avons , cependant, vécu avec toute cette merde jusqu’à un point de suffocation et de claustrophobie, rabaissés par des monuments excrémentiels et des musées mausoléoïdes emplis de pièces isolées et immobiles, aliénées et séparées d’art mort. Mis à part le charmant culte ésotérique personnel de l’artiste souligné dans les derniers paragraphes, quel but peut servir à présent notre art ? Pourquoi le faire ? et pour qui ?
Si nous retournons à présent au monde de la « propagande », il doit être évident que nous voulons charger ce terme de plus que la portée habituelle de sa signification. Dans les nations totalitaires, la censure travaille par le diktat ; dans les nations démocratiques, le Marché accomplit la même finalité, puisque toutes choses qui échoue en tant que marchandise ne peut causer de dommages à l’Empire. L’avant-garde et le « peuple » ont tous deux été réduits à des fournisseurs d’images pour la publicité ; le temps mort entre la naissance d’une nouvelle forme d’art et de son appropriation par le Média du Consensus a déjà cessé d’exister. Dans une telle situation, tout art qui réussit à passer entre les mailles du filet du monolithe ou à survivre dans une existence marginale ne peut avoir qu’un seul but : la propagande, la propagande insurrectionnelle.
Cela ne signifie pas que « l’art est au service de la révolution » – une tyrannie impossible – ni un Réalisme Social , ni toute forme reconnaissable d’art politique. L’ordure est l’ordure, peu importe combien pures sont ses intentions. Non, pour l’Anti-Calife, l’art est la politique, l’art est la révolution, l’art est la religion. L’art qui réussit dans la beauté et ne peut être absorbé par la Machine est déjà de la propagande pour la vérité, qu’importent son style et son contenu, car il est déjà une manifestation de la vérité sous une forme ordonnée et connaissable. Que la populace prenne ces mots dans leurs sens platoniques : par « vérité » nous ne signifions pas un Idéal abstrait et sans corps, ni même un sentiment mystique non verbal. C’est quelque chose de plus simple et cependant de plus difficile à expliquer ou à définir, quelque chose pour laquelle nous utiliserons le mot arabo-persan de zawq [40] et le terme sanskrit/javanais rasa [41] :
GOUT, INTUITION – SENTIMENT – CATEGORIE ESTETHIQUE – l’intériorisation d’une perception (« devenir le bambou » comme le dit la Jardin du Grain de Moutarde) – donc une sorte d’état de conscience mystique / esthétique – un sens que ce qui « convient » – la faculté de choisir ou de discriminer, choisir cette couleur ou cette note ou ce mot et pas cet autre – mise en valeur artistique, « bon goût » – la qualité d’une représentation ou d’une oeuvre d’art – un « goût » comme expérience directe, certitude expérimentale…
Ici, nous atteignons la point central de l’exercice de la propagande ésotérique, le terme clé du texte et la plus proche approximation d’une voie spirituelle réelle « recommandée » par l’Anti-Calife : la culture du goût à la fois en tant que travail sur soi et en tant que propagande pour la cause « ésotérique ». Pour réveiller dans autrui le désir pour ce qui peut difficilement se dire par les mots si ce n’est par des clichés ou des noms divins – le désir pour le désir, l’Eros fils du Chaos – le goût pour la vie elle-même et pour aucune autre de ses représentations bon marché ou substituts mensongers : le désir d’être l’art, spontanément et absolument.
Pour le futur, donc, l’Anti-Calife recommande que chacun soit un artiste. D’abord, certains arts traditionnels doivent être repris, telle la musique classique de Perse et du nord de l’Inde, la poésie, les arts martiaux de l’Extrême-Orient, la danse javanaise, la musique et la calligraphie. De telles traditions ne méritent pas la préservation par quelque bonté d’âme mais en tant que possibilités vivantes. Comme parler une autre langue, ils nous aident à sortir de notre peau culturelle – et ils fournissent le terrain pour une inter fertilisation et pour le syncrétisme. Toute la Sagesse Orientale a été rendue accessible à notre siècle ; la culture cosmopolite sans racine du futur créera des mosaïques et des mandalas sans fin à partir des milliers de tribus et de civilisations.
L’Adab, qui signifie à la fois « bonnes manières » et « culture esthétique » aussi bien que littérature et voie spirituelle, est une qualité qui semble appropriée à l’artiste et à l’anarchiste. Emma Goldman a dit une fois que dans une société anarchiste, tout le monde serait un aristocrate : « l’aristocratisme radical » comme Nietzsche l’a formulé.
L’art de l’amour est conjoint aux autres arts et est également leur « Muse » en chef : le sama [42] soufi interprété comme fête d’amour esthétique et érotique ; l’intoxication de la musique, de la poésie, de la danse, de la présence du bien-aimé ou de la bien-aimée.
L’hospitalité en tant que forme d’art. Les javanais offrent des « Banquets de Paix » (slametan) afin d’apaiser les esprits, de célébrer la chance ou des rites de passage, comme excuse pour la bonne chair et l’amusement, mais avec un but spirituel. Les voisins et les passants sont invités dans un esprit de convivialité et d’ouverture.
Des salons, des musicales, des symposium, des pèlerinages vers des lieux de beauté géomantiques ou de pouvoir baroque et excentrique ; des célébrations publiques du grand oeuvre de l’art ou de l’exquise folie – finalement la création d’un refuge dédié aux moments de libertés esthétiques et de « goût » mystique.
Le « Terrorisme Poétique » – l’art en tant que propagande par les faits – l’assassinisme-esthétique. L’art propagandiste puissant devrait produire de puissantes émotions ou rasa – aussi puissantes que la terreur ou la joie – déchirant violemment les voiles de l’inattention, de la stupidité inesthétique, de l’égoïsme traître à lui-même et de l’oubli par des actes d’art inattendus – une sorte de « Théâtre de la Cruauté » sans les murs.
Et comme suggestion finale (avant que l’Anti-Calife retourne dans le Monde des Archétypes) : la création des jours de fêtes, de purs actes de célébrations. Par exemple, le 17e jour de Ramadan, anniversaire Ibn Arabî et anniversaire de la Qiyamat – un banquet pour proclamer l’Unité de l’Être, la Sagesse Intérieure, la brisure des chaînes de la Loi.
Retour aux autres parties de l’article :
Plus sur le sujet :
L’Anti Calife 3, par Peter Lamborn Wilson.
Image parAbdullah Shakoor de Pixabay
Notes :
[35] Le gamelan est un ensemble instrumental indonésien, de type traditionnel, composé principalement de percussions : parmi celles-ci des gongs, des métallophones, des xylophones, des cymbales, des tambours, parfois des flûtes. Ce terme s’applique à la fois au groupe d’instruments que pour les joueurs des dits instruments.
[36] Le batik (mot javanais) est une technique d’impression des étoffes pratiquée dans des pays tels que le Burkina Faso, la Chine, l’Indonésie, l’Inde, le Sri Lanka etc. Le procédé consiste à appliquer une teinture sur un tissu après avoir masqué certaines zones avec de la cire de manière à les préserver. Après séchage, la cire est fondue puis l’opération peut être renouvelée avec une autre couleur et ce autant de fois que nécessaire. Au final on obtient un tissu où se mêlent différents tons juxtaposés ou superposés.
[37] La Kebatinan est un ensemble de pratiques traditionnelles qui enseigne la réception et la mise en valeur de la réalité (le mot dérive de batin, réalité). Les différentes disciplines sont destinées à aider à connaître et à utiliser les sens mieux et de percevoir la réalité plus clairement. La forme traditionnelle de la kabatinan est une série de tapa (jeûnes, disciplines et austérités) qui sont généralement pratiquées en secret, avec la relation entre le maître et l’élève (guru et murid) qui doit rester secrète.
[38] en français dans le texte.
[39] Ouroboros désigne le dessin d’un serpent ou d’un dragon qui se mord la queue. Il s’agit d’un mot de grec ancien ουροβοροs, latinisé sous la forme uroborus qui signifie littéralement « qui se mord la queue ». Ce symbole apparaît souvent sous la forme d’un double serpent se mordant respectivement la queue l’un de l’autre.
[40] saveur [Zawq] : terme technique dans le soufisme qui signifie le « goût » de l’expérience mystique, souvent une qualité qui ne peut être décrite par les mots. « Celui qui ne goûte pas, ne sait pas » (dicton arabe).
[41] émotions, sentiments
[42] Mot arabe qui renvoie à la notion d’audition spirituelle. Le sama fait partie des pratiques spirituelles du soufisme, parmi lesquelles on trouve notamment le dhikr (invocation des noms divins), la lecture du Qur’an, la récitation de prière sur le prophète Muhammad. Les séances de sama constituent une modalité particulière de l’invocation divine au sein des confréries soufies. La poésie mystique chantée a capella dans le sama associe les thèmes de l’amant et de l’aimé, de l’ivresse spirituelle, de la nostalgie de la séparation…